Trois femmes remarquables
En plus des deux femmes admirables que nous vous présentons ci-dessous en relation avec le thème du numéro, nous vous présentons une autre femme admirable qui est à l'origine dela déclaration universelle des droits humains dont Amnesty a célèbré le soixantième anniversaire en décembre dernier. Il s'agit de :
Eleanor Roosevelt.
Première dame des Etats-Unis de 1933 à 1945, elle sera la première à y occuper un rôle actif.
Elle aura d'abord contribué à l'élection de son mari à la présidence des Etats Unis. Elle pèsera sur la décision d'engager le pays dans la Seconde Guerre mondiale. Elle n’hésitera pas à rendre visite aux troupes sur le front.
Féministe engagée, elle s'opposera au racisme et défendra le Mouvement américain pour les droits civiques.
Après le conflit, elle joue un rôle déterminant dans la création de l’Organisation des Nations unies (ONU) puis, Franklin ayant disparu avant la fin de son dernier mandat, préside la commission chargée de rédiger la Déclaration universelle des droits humains (pendant la présidence de Harry S. Truman).
Ses nombreux voyages dans le monde et sa diplomatie contribuent de façon décisive à l'adoption de cette déclaration par l'Assemblée générale des Nations Unies 1948.
Grace à elle, pour la première fois dans un traité international, il est explicitement déclaré l'égalité entre les êtres humains, quel que soit leur sexe.
C'est elle qui lira cette déclaration, réellement universelle, à la tribune de l'Organisation des Nations unies.
Elle considérait cette déclaration comme l'achèvement suprême de sa vie.
Quelques -unes de ses paroles :
* « You have to accept whatever comes, and the only important thing is that you meet it with courage and with the best that you have to give. »
* « The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. »
* « No one can make you feel inferior without your consent. »
* « Do what you feel in your heart to be right — for you’ll be criticized anyway. You'll be damned if you do, and damned if you don’t. »
* «The structure of the world peace cannot be the work of one human being, or one party or one nation. it must be a peace which reste on the cooperative effort of the whole world.»

Nous voulons partager avec vous notre admiration pour deux femmes qui se sont battues pour d'autres femmes, pour la détresse d'autres femmes.
Simone Veil -
Déportée à l'âge de dix-sept ans à Auschwitz, Simone Veil entreprend après la guerre des études de droit et de sciences politiques à l'IEP de Paris et devient magistrate. En 1969, elle entre en politique en rejoignant le cabinet de René Pleven, Garde des Sceaux. Mais sa véritable carrière politique démarre au début du septennat de Valéry Giscard d'Estaing ; ayant décidé de féminiser son gouvernement, il l'appelle au ministère de la Santé.
Elle libéralise l'accès à la contraception et s'illustre en faisant voter en 1975 la loi portant son nom sur l'interruption volontaire de grossesse.
Elle racontera que, pendant la période du débat à l'Assemblée National, elle reçoit des menaces à son domicile, elle trouve des croix gammées sur sa voiture dont on a brisé les vitres, elle qui a connu Auschwitz et qui a perdu sa mère, son père et son frère dans les camps de la mort. La violence qui s'exerce alors vient de cette frange extrémiste du christianisme qui sévit toujours aux Etats Unis.
Ardente militante européenne, elle conduit la liste UDF aux premières élections européennes de 1979. Elue député, elle devient la première femme présidente du Parlement européen (1979-1982). En 1993, elle quitte ses mandats européens et rejoint le gouvernement Balladur pour s'occuper des Affaires sociales, de la santé et de la ville, et devient la première femme ministre d'Etat. Depuis 1998, elle est membre du Conseil constitutionnel.
Parallèlement, Simone Veil soutient de nombreuses associations à vocation européenne, telle que le Fonds européen pour la liberté d'expression, ou encore la Fondation de l'Europe des sciences et de la culture, dont elle est présidente d'honneur.
Quelques commentaires sur sa biographie publiée récemment :
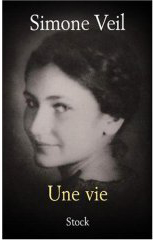
1 - Que l'on soit de droite, de gauche, ou de nulle part, pour une femme née entre 1950 et 1970, Simone Veil, c'est une référence, je dirais même : C'est une "dame" !
On connait toutes ses faits d'armes, ses engagements, ses combats. On sait toutes qu'on lui doit beaucoup...
J'ai été heureuse de découvrir sa vie à travers cette biographie. Ce n'est ni prétentieux, ni moralisateur, ni sentencieux. Les mémoires d'une vraie dame, en fait... Une vie, certes, mais pas n'importe laquelle. Une vie bien loin de la pauvre Jeanne de Maupassant. La vie d'une femme simple, certes, mais qui restera dans l'histoire !
2 - A l'aube de ses 80 ans, Simone Veil déroule le film de sa vie marquée par beaucoup de souffrances et de chagrins mais aussi et surtout par la volonté de donner un sens à son existence. Elle aurait pu ne jamais revenir des camps de la mort ou sombrer dans la dépression, mais son enfance heureuse auprès de sa mère notamment lui a permis de construire à son tour un foyer équilibré avec son mari Antoine.
Le style littéraire de Mme Veil est à son image : concis, précis, sans atermoiements ni drame, mettant en lumière son oeuvre politique et ses engagements et rendant hommage aux Justes, ces français courageux qui ont sauvé tellement de vies juives des griffes nazies.
J'ai lu cette autobiographie d'une traite et en la refermant, j'ai ressenti beaucoup d'émotion...
3 - Une enfance traumatique, le vécu de l'horreur sans en faire une carte de visite, une fidélité à ses valeurs humaines et à ses convictions, on découvre dans un style extrêmement précis et bien écrit, une femme digne, juste, droite, loyale, fidèle à elle même, évitant les raccourcis démagogiques et le manichéïsme. C'est une femme à laquelle on aimerait ressembler.
C'est un livre qui exalte, qui donne envie d'agir, d'oeuvrer dans le sens de la liberté, l'égalité et la fraternité.
Evidemment il y a la partie de la jeunesse, la guerre, les camps. mais cela n'a servi qu'à forger une femme battante, ambitieuse peut-être, mais qui ne l'est pas en politique ? Sa vue de l'europe et de l'avortement m'ont beaucoup touchée moi qui ai eu une vie plus féminine grâce à elle. Il n'y a pas de "people", et bien tant mieux, cela change des livres actuels. J'ai été émue et ... si je pouvais avoir sa vitalité à son âge, moi qui ne l'ai pas avec 30 ans de moins. un bel exemple du combat des femmes en politique ...Et sans mariage avec Mr...

Gisèle Halimi
Gisèle Halimi entre au barreau de Tunis en 1949 et poursuit sa carrière d'avocate à Paris en 1956.
Fortement engagée dans plusieurs causes, elle milite pour l'indépendance de son pays la Tunisie et aussi pour l'Algérie, elle dénonce les tortures pratiquées par l'armée française et défend les militants du MNA (mouvement national algérien) poursuivis par la justice française. Elle co-signe avec Simone de Beauvoir Djamila Boupacha, livre dans lequel elle obtient de nombreux soutiens et la participations de grands noms comme Picasso dont le portrait de Djamila Boupacha figure sur la couverture.
Dans le même esprit, elle préside une commission d'enquête sur les crimes de guerres américains au Viêt Nam.
Féministe, Gisèle Halimi est signataire en 1971 du Manifeste des 343, les 343 femmes qui déclarent avoir avorté et réclament le libre accès aux moyens anticonceptionnels et l'avortement libre.
Aux côtés de Simone de Beauvoir, elle fonde en 1971 le mouvement féministe Choisir la cause des femmes et milite en faveur de la dépénalisation de l'avortement.
Au procès de Bobigny en 1972, qui eut un retentissement considérable, elle défend une mineure qui s'était fait avorter après un viol, en en faisant une tribune contre la loi de 1920. Ce procès a contribué à l'évolution vers la loi Veil de 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse.
Élue à l'Assemblée nationale de 1981 à 1984 elle constate avec amertume que ses projets n'avancent pas autant qu'elle le souhaiterait et elle dénonce un bastion de la misogynie. Gisèle Halimi est également une des fondatrices de l'association altermondialiste ATTAC.
En mars et avril 2006, la télévision française a diffusé Le Procès de Bobigny, un téléfilm de François Luciani dans lequel Anouk Grinberg interprète le rôle de Gisèle Halimi et Sandrine Bonnaire celui de la mère qui aida sa fille mineure à avorter.
Au procès de Bobigny, avec l'accord des prévenues, leur avocate Gisèle Halimi a donc choisi de faire du procès une tribune. « J'ai toujours professé que l'avocat politique devait être totalement engagé aux côtés des militants qu'il défend. Partisan sans restriction avec, comme armes, la connaissance du droit "ennemi", le pouvoir de déjouer les pièges de l'accusation, etc. (...) Les règles d'or des procès de principe: s'adresser, par-dessus la tête des magistrats, à l'opinion publique tout entière, au pays. Pour cela, organiser une démonstration de synthèse, dépasser les faits eux-mêmes, faire le procès d'une loi, d'un système, d'une politique. Transformer les débats en tribune publique. Ce que nos adversaires nous reprochent, et on le comprend, car il n'y a rien de tel pour étouffer une cause qu'un bon huis clos expéditif. »
La plaidoirie passionnée de Gisèle Halimi fait valoir que désobéir à une loi injuste, c'est faire avancer la démocratie. Elle plaide: « Regardez-vous messieurs. Et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant des hommes. Pour parler de quoi ? D’utérus, de grossesses, d’avortements. Ne croyez-vous pas que l’injustice fondamentale soit déjà là ? »
Le mouvement Choisir publie juste après le procès, en poche chez Gallimard, Avortement. Une loi en procès, L'affaire de Bobigny, préfacé par Simone de Beauvoir. Ce livre est une transcription intégrale de l'audience, des exclamations aux questions parfois saugrenues comme lorsque le président du tribunal demande à l'avorteuse si elle a mis le spéculum dans la bouche... En quelques semaines et sans publicité, plus de 30 000 exemplaires sont vendus.
Une nouvelle édition de ce livre a été publié en 2006 :
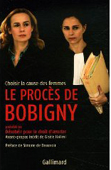 Dans cette nouvelle édition d'un livre qui fait date, on trouvera un texte où, pour la première fois, Marie-Claire, aujourd'hui elle-même mère d'une fille de seize ans, s'exprime. Récit des souffrances et bilan de son combat.
Dans cette nouvelle édition d'un livre qui fait date, on trouvera un texte où, pour la première fois, Marie-Claire, aujourd'hui elle-même mère d'une fille de seize ans, s'exprime. Récit des souffrances et bilan de son combat.
On trouvera également un avant-propos inédit de Gisèle Halimi, l'avocate du procès, qui assimile cette phase de la libération des femmes à la désobéissance civique. Refuser une loi injuste pour en faire naître une autre, conforme au droit pour les femmes de choisir de donner (ou non) la vie. La plus fondamentale de leurs libertés.
Le manifeste des 343
Il s'agit de l'un des exemples les plus connus de désobéissance civile en France. Il a inspiré en 1973 un manifeste de 331 médecins se déclarant pour la liberté de l'avortement. Il a surtout contribué à l'adoption, en décembre 1974-janvier 1975 de la loi Veil qui dépénalisait l'interruption volontaire de grossesse (IVG) lors des dix premières semaines de grossesse, un délai porté depuis à douze semaines.
Le combat pour que les femmes puissent décider librement d'assumer ou non la responsabilité d'élever un enfant est toujours d'actualité dans nombre de pays. (voir le thème du numéro)

